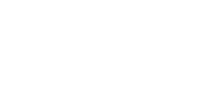Alan Guyomarch - Université de Bourgogne - Centre de recherche Cerveau et Cognition (CerCo)
Sciences du sport (2024 - thèse en cours)
Effets des processus identitaires sur les mécanismes de perception visuelle : étude des joueurs de sports collectifs
Co-direction de la thèse : Benoit COTTEREAU (directeur de recherche CNRS) et Mickael CAMPO (HDR).
Centre de Recherche Cerveau et Cognition - Psy-DREPI laboratory
Dans les sports collectifs, le sentiment d'appartenance à l'équipe est corrélé à différentes variables associées à la performance comme la cohésion et la confiance en l'équipe (Fransen et al., 2014), l'augmentation des efforts (De Cuyper et al., 2016), le sentiment d'auto-efficacité, la perception de contrôle de ses performances, la perception de support social (Miller et al., 2020), la sécurité psychologique, la résilience collective et la satisfaction des performances de l'équipe (Fransen et al., 2020), ou encore les émotions (Campo et al., 2019). Toutefois, les associations entre sentiment d'appartenance au groupe et variables de performance reposent majoritairement sur des mesures subjectives (Stevens et al., 2021), qui peuvent être soumises à différents biais. Notre projet de recherche vise à dépasser ces limites en questionnant l'effet du sentiment d'appartenance au groupe sur le traitement de l'information visuelle et la prise de décision dans les sports collectifs. Dans un premier temps, nous cherchons à savoir si les relations sociales (e.g., familiarité entre individus, familiarité entre groupes d'individus, sentiment d'appartenance partagé à un groupe) peuvent impacter le traitement de l'information visuelle dans des contextes généraux, notamment dans le cadre de la reconnaissance des visages. Cette étude des mécanismes généraux nous permettra ensuite d'étudier la manière dont ces éventuels biais peuvent se traduire dans le contexte des sports collectifs et impacter la performance. Ainsi, des études mettent en évidence un effet de la familiarité du stimulus sur la capacité à reconnaître les visages (voir pour revue Johnston et Edmonds, 2009). Cet effet impliquerait les régions sélectives aux visages dans les aires visuelles mais aussi des régions plus générales antérieures et médiales du lobe temporal liées au rappel en mémoire des informations biographiques, des noms et des réponses émotionnelles liées aux visages familiers (Gobbini & Haxby, 2007). De surcroît, certains articles défendent l'idée selon laquelle les individus sont plus ou moins familiers avec des classes de stimuli (e.g., visages d'une certaine ethnie, visages d'individus d'un certain genre, etc.), ce qui pourrait biaiser le traitement de l'information visuelle. Des preuves expérimentales, notamment dans le cadre d'études s'intéressant à l'« effet de race », mettent en évidence des différences de traitement de l'information selon l'origine ethnique de la personne présentée en tant que stimulus. Ainsi, la composante ERP N170, le DM effect et l' « old/new effect » seraient impactés (Tüttenberg & Wiese, 2021 pour revue). Les auteurs concluent leur revue en affirmant que les biais de traitement des visages des individus seraient liés à un manque d'habitude à traiter des visages d'individus ayant d'autres origines ethniques. Enfin, une approche dite socio-cognitive défend l'idée selon laquelle les biais de traitement de l'information visuelle seraient liés à des différences de motivation à traiter l'information associée à des individus n'appartenant pas au groupe du participant. En effet, en s'appuyant sur l'Approche de l'Identité Sociale (Haslam, 2004) qui stipule que les individus favorisent leur groupe d'appartenance au détriment des autres groupes pour valoriser leur identité sociale, certains auteurs ont observé une activation accrue des aires cérébrales impliquées dans le traitement des visages lorsque les participants visualisent des membres de leur propre groupe. Ces effets se retrouvent au niveau de l'activité du gyrus fusiforme dans un paradigme des groupes minimaux (Van Bavel et al., 2008). Dans ces études, les groupes auxquels les participants sont assignés n'ont aucune signification pour eux (i.e., voir Tajfel, 1971). Des résultats similaires sont retrouvés en EEG chez Derks et al. (2015) et Domen et al. (2020). Toutefois, que ce soit en ce qui concerne la familiarité avec le stimulus, la classe de stimuli ou le sentiment d'appartenance au groupe, les résultats des études sont peu reproductibles. Par exemple, Rossion et al. (1999) ne montrent pas d'effet de la familiarité du stimulus sur la composante N170, au même titre que Hong et al. (2022) avec l'appartenance à un groupe minimal. De nombreuses raisons peuvent être mobilisées pour expliquer cette inconsistance dans les résultats. En effet, les méthodes traditionnellement utilisées en EEG et IRMf ne permettent pas d'identifier de manière directe les réponses corticales, ne renseignent pas sur la généralisation du traitement d'une classe de stimuli, demandent la réalisation d'un nombre conséquent d'essais du fait de leur faible ratio signal/bruit et enfin nécessitent que les stimuli soient contrôlés, notamment en regard des caractéristiques visuelles de bas niveau (e.g., saillance, luminance), limitant la validité écologique des résultats. Ainsi, notre projet se propose d'étudier l'impact de variables associées aux relations entre individus (e.g., familiarité avec les stimuli, familiarité avec les classes de stimuli, sentiment d'appartenance au groupe) sur le traitement de l'information visuelle en utilisant des méthodes innovantes issues des neurosciences cognitives. Des méthodes de tagging fréquentiel (voir Yan & Rossion, 2020 en EEG ; Gao et al., 2018 ou Laurent et al., 2023 en IRMf) seront utilisées afin de fournir des mesures objectives avec un rapport signal à bruit élevé. Cela nous permettra de mesurer comment différents marqueurs des relations sociales entre individus peuvent influencer le traitement de l'information visuelle, voire d'étudier les interactions qui peuvent exister entre eux. Une fois ces éléments mieux compris, notre projet cherchera à comprendre comment ces éventuels biais de traitement de l'information visuelle associés aux relations sociales impactent la performance sportive. Pour cela, nous simulerons en laboratoire des situations proches de la réalité du terrain afin de mesurer comment les stratégies de recherche visuelle sur le terrain peuvent être influencées par les relations sociales avec les coéquipiers et les adversaires, et comment ces différences peuvent impacter la performance.
Centre de Recherche Cerveau et Cognition - Psy-DREPI laboratory
Dans les sports collectifs, le sentiment d'appartenance à l'équipe est corrélé à différentes variables associées à la performance comme la cohésion et la confiance en l'équipe (Fransen et al., 2014), l'augmentation des efforts (De Cuyper et al., 2016), le sentiment d'auto-efficacité, la perception de contrôle de ses performances, la perception de support social (Miller et al., 2020), la sécurité psychologique, la résilience collective et la satisfaction des performances de l'équipe (Fransen et al., 2020), ou encore les émotions (Campo et al., 2019). Toutefois, les associations entre sentiment d'appartenance au groupe et variables de performance reposent majoritairement sur des mesures subjectives (Stevens et al., 2021), qui peuvent être soumises à différents biais. Notre projet de recherche vise à dépasser ces limites en questionnant l'effet du sentiment d'appartenance au groupe sur le traitement de l'information visuelle et la prise de décision dans les sports collectifs. Dans un premier temps, nous cherchons à savoir si les relations sociales (e.g., familiarité entre individus, familiarité entre groupes d'individus, sentiment d'appartenance partagé à un groupe) peuvent impacter le traitement de l'information visuelle dans des contextes généraux, notamment dans le cadre de la reconnaissance des visages. Cette étude des mécanismes généraux nous permettra ensuite d'étudier la manière dont ces éventuels biais peuvent se traduire dans le contexte des sports collectifs et impacter la performance. Ainsi, des études mettent en évidence un effet de la familiarité du stimulus sur la capacité à reconnaître les visages (voir pour revue Johnston et Edmonds, 2009). Cet effet impliquerait les régions sélectives aux visages dans les aires visuelles mais aussi des régions plus générales antérieures et médiales du lobe temporal liées au rappel en mémoire des informations biographiques, des noms et des réponses émotionnelles liées aux visages familiers (Gobbini & Haxby, 2007). De surcroît, certains articles défendent l'idée selon laquelle les individus sont plus ou moins familiers avec des classes de stimuli (e.g., visages d'une certaine ethnie, visages d'individus d'un certain genre, etc.), ce qui pourrait biaiser le traitement de l'information visuelle. Des preuves expérimentales, notamment dans le cadre d'études s'intéressant à l'« effet de race », mettent en évidence des différences de traitement de l'information selon l'origine ethnique de la personne présentée en tant que stimulus. Ainsi, la composante ERP N170, le DM effect et l' « old/new effect » seraient impactés (Tüttenberg & Wiese, 2021 pour revue). Les auteurs concluent leur revue en affirmant que les biais de traitement des visages des individus seraient liés à un manque d'habitude à traiter des visages d'individus ayant d'autres origines ethniques. Enfin, une approche dite socio-cognitive défend l'idée selon laquelle les biais de traitement de l'information visuelle seraient liés à des différences de motivation à traiter l'information associée à des individus n'appartenant pas au groupe du participant. En effet, en s'appuyant sur l'Approche de l'Identité Sociale (Haslam, 2004) qui stipule que les individus favorisent leur groupe d'appartenance au détriment des autres groupes pour valoriser leur identité sociale, certains auteurs ont observé une activation accrue des aires cérébrales impliquées dans le traitement des visages lorsque les participants visualisent des membres de leur propre groupe. Ces effets se retrouvent au niveau de l'activité du gyrus fusiforme dans un paradigme des groupes minimaux (Van Bavel et al., 2008). Dans ces études, les groupes auxquels les participants sont assignés n'ont aucune signification pour eux (i.e., voir Tajfel, 1971). Des résultats similaires sont retrouvés en EEG chez Derks et al. (2015) et Domen et al. (2020). Toutefois, que ce soit en ce qui concerne la familiarité avec le stimulus, la classe de stimuli ou le sentiment d'appartenance au groupe, les résultats des études sont peu reproductibles. Par exemple, Rossion et al. (1999) ne montrent pas d'effet de la familiarité du stimulus sur la composante N170, au même titre que Hong et al. (2022) avec l'appartenance à un groupe minimal. De nombreuses raisons peuvent être mobilisées pour expliquer cette inconsistance dans les résultats. En effet, les méthodes traditionnellement utilisées en EEG et IRMf ne permettent pas d'identifier de manière directe les réponses corticales, ne renseignent pas sur la généralisation du traitement d'une classe de stimuli, demandent la réalisation d'un nombre conséquent d'essais du fait de leur faible ratio signal/bruit et enfin nécessitent que les stimuli soient contrôlés, notamment en regard des caractéristiques visuelles de bas niveau (e.g., saillance, luminance), limitant la validité écologique des résultats. Ainsi, notre projet se propose d'étudier l'impact de variables associées aux relations entre individus (e.g., familiarité avec les stimuli, familiarité avec les classes de stimuli, sentiment d'appartenance au groupe) sur le traitement de l'information visuelle en utilisant des méthodes innovantes issues des neurosciences cognitives. Des méthodes de tagging fréquentiel (voir Yan & Rossion, 2020 en EEG ; Gao et al., 2018 ou Laurent et al., 2023 en IRMf) seront utilisées afin de fournir des mesures objectives avec un rapport signal à bruit élevé. Cela nous permettra de mesurer comment différents marqueurs des relations sociales entre individus peuvent influencer le traitement de l'information visuelle, voire d'étudier les interactions qui peuvent exister entre eux. Une fois ces éléments mieux compris, notre projet cherchera à comprendre comment ces éventuels biais de traitement de l'information visuelle associés aux relations sociales impactent la performance sportive. Pour cela, nous simulerons en laboratoire des situations proches de la réalité du terrain afin de mesurer comment les stratégies de recherche visuelle sur le terrain peuvent être influencées par les relations sociales avec les coéquipiers et les adversaires, et comment ces différences peuvent impacter la performance.
Mise à jour le 29 septembre 2025