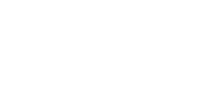Anthony Forestier - Post-doct | Université de Reims Champagne-Ardenne.
STAPS - Thèse soutenue le 11/06/2025
Ethnographie des socialisations scolaires d'élèves allophones en situation migratoire : (faire) apprendre l'école par corps et par cœur.
Co-direction : Gilles Combaz (professeur émérite Université Lyon 2) et Gaëlle Sempé (maîtresse de conférences Université Rennes 2)
Résumé :
À partir d’une sociologie dispositionnaliste et contextualiste, cette thèse analyse les socialisations scolaires d’élèves allophones nouvellement arrivés en France. Dotés d’un patrimoine de dispositions pluriel et dynamique – façonné au cours de leur parcours de vie en terres d’émigration puis d’immigration, selon leur position dans les rapports sociaux –, ces élèves incorporent et habitent inégalement les normes scolaires. Déployée dans un lycée, un collège et deux écoles primaires, cette enquête ethnographique s’appuie sur des observations quotidiennes menées sur le temps long, des entretiens, ainsi que sur le recueil de productions et de documents scolaires. Dans une première partie, nous proposons une analyse intra-individuelle de dix portraits d’élèves dont l’âge, le sexe, l’origine sociale et la nationalité varient. En plus d’éclairer des scolarités inégales et complexes, ces portraits font ressortir les variations, les transformations et les renforcements dispositionnels permettant aux allophones de s’ajuster (ou non) aux exigences professorales. Tandis que l’acculturation scolaire s’avère difficile pour certains, d’autres oscillent entre des ajustements et des désajustements qui sont à la fois non linéaires, pas toujours stabilisés et donc potentiellement réversibles au cours de leur scolarité française. En parallèle, une minorité d’entre eux arrivent déjà « faits » pour l’école et disposés pour y réussir. Ainsi, derrière les grandes mobilités migratoires de ces élèves s’observent de petites mobilités dispositionnelles ; elles-mêmes rendues possibles par les expériences incorporées avant la migration et certains ressorts de transformation présents dans les contextes scolaires investigués. À la suite de ce raisonnement par cas, une analyse inter-individuelle explore plus globalement le déploiement (par l’institution) et les réceptions (par les élèves) d’un processus d’enveloppement scolaire. Par l’intermédiaire de celui-ci, les enseignants entendent transformer les allophones jusqu’à leur intégration totale en classe ordinaire, en leur faisant apprendre l’école « par corps » et « par cœur ». En plus de l’Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants au sein de laquelle ils sont inscrits et que nous identifions comme un contexte socialisateur maternant, cet enveloppement scolaire se diffuse dans les autres espaces de l’établissement à travers : un quadrillage de l’espace, un encadrement du temps, l’imposition d’une langue, la disciplinarisation de l’hexis corporelle (via la posture, la tenue vestimentaire, leurs rapports au sport, à l’hygiène et à la santé, aux pratiques alimentaires) ainsi qu’un contrôle des émotions. Cependant, les allophones réceptionnent inégalement les normes scolaires. Ce travail souligne donc l’importance de tenir compte de leur passé incorporé, de leurs conditions d’existence en France et de leurs socialisations amicale et familiale ; ces dernières pouvant renforcer ou freiner l’action socialisatrice des enseignants. In fine, l’étude des socialisations scolaires d’élèves allophones reflète, en filigrane, les enjeux politiques et éducatifs qui se nichent derrière l’accueil et la prise en charge, par l’école, des enfants et des jeunes en situation migratoire.
Résumé :
À partir d’une sociologie dispositionnaliste et contextualiste, cette thèse analyse les socialisations scolaires d’élèves allophones nouvellement arrivés en France. Dotés d’un patrimoine de dispositions pluriel et dynamique – façonné au cours de leur parcours de vie en terres d’émigration puis d’immigration, selon leur position dans les rapports sociaux –, ces élèves incorporent et habitent inégalement les normes scolaires. Déployée dans un lycée, un collège et deux écoles primaires, cette enquête ethnographique s’appuie sur des observations quotidiennes menées sur le temps long, des entretiens, ainsi que sur le recueil de productions et de documents scolaires. Dans une première partie, nous proposons une analyse intra-individuelle de dix portraits d’élèves dont l’âge, le sexe, l’origine sociale et la nationalité varient. En plus d’éclairer des scolarités inégales et complexes, ces portraits font ressortir les variations, les transformations et les renforcements dispositionnels permettant aux allophones de s’ajuster (ou non) aux exigences professorales. Tandis que l’acculturation scolaire s’avère difficile pour certains, d’autres oscillent entre des ajustements et des désajustements qui sont à la fois non linéaires, pas toujours stabilisés et donc potentiellement réversibles au cours de leur scolarité française. En parallèle, une minorité d’entre eux arrivent déjà « faits » pour l’école et disposés pour y réussir. Ainsi, derrière les grandes mobilités migratoires de ces élèves s’observent de petites mobilités dispositionnelles ; elles-mêmes rendues possibles par les expériences incorporées avant la migration et certains ressorts de transformation présents dans les contextes scolaires investigués. À la suite de ce raisonnement par cas, une analyse inter-individuelle explore plus globalement le déploiement (par l’institution) et les réceptions (par les élèves) d’un processus d’enveloppement scolaire. Par l’intermédiaire de celui-ci, les enseignants entendent transformer les allophones jusqu’à leur intégration totale en classe ordinaire, en leur faisant apprendre l’école « par corps » et « par cœur ». En plus de l’Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants au sein de laquelle ils sont inscrits et que nous identifions comme un contexte socialisateur maternant, cet enveloppement scolaire se diffuse dans les autres espaces de l’établissement à travers : un quadrillage de l’espace, un encadrement du temps, l’imposition d’une langue, la disciplinarisation de l’hexis corporelle (via la posture, la tenue vestimentaire, leurs rapports au sport, à l’hygiène et à la santé, aux pratiques alimentaires) ainsi qu’un contrôle des émotions. Cependant, les allophones réceptionnent inégalement les normes scolaires. Ce travail souligne donc l’importance de tenir compte de leur passé incorporé, de leurs conditions d’existence en France et de leurs socialisations amicale et familiale ; ces dernières pouvant renforcer ou freiner l’action socialisatrice des enseignants. In fine, l’étude des socialisations scolaires d’élèves allophones reflète, en filigrane, les enjeux politiques et éducatifs qui se nichent derrière l’accueil et la prise en charge, par l’école, des enfants et des jeunes en situation migratoire.
- Thématique(s)
- Recherche - Valorisation, Débouchés
Mise à jour le 1 septembre 2025