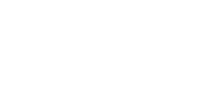On entend souvent dire que l’effort est perçu comme désagréable, chacun étant enclin à céder aux sirènes du moindre effort. Mais alors, comment expliquer que tant de personnes se lancent, par exemple, dans des marathons, en dépit de l’effort évident qu’implique cette activité physique ? En décryptant les trois phases de l’effort (avant, pendant et après), nous pouvons lutter contre notre tendance naturelle à la paresse.
Se creuser la tête sur un puzzle, monter un escalier, pratiquer une activité physique intense… l’effort est consubstantiel à nombre de nos actions. Sa perception influence non seulement notre motivation immédiate à agir, mais aussi notre engagement durable dans le temps.
Souvent vu comme un coût, l’effort peut constituer une barrière majeure à l’engagement dans des tâches exigeantes, qu’elles soient physiques ou mentales.
L’effort, une composante essentielle de nos comportements
Pendant longtemps, la recherche a considéré l’effort comme un coût à éviter, dans un monde où notre environnement permet de plus en plus de minimiser nos efforts. C’est dans cette perspective que nous avons formulé la théorie de la minimisation de l’effort en activité physique (theory of effort minimization in physical ou TEMPA), selon laquelle nous sommes naturellement enclins à une certaine paresse physique.
Pourtant, cette vision demeurait incomplète. Dans un même contexte donné, pourquoi certains d’entre nous s’adonnent-ils régulièrement – et parfois excessivement – à une activité physique, tandis que d’autres peinent à traduire leurs louables intentions en actions ? Certains travaux montrent que, si l’effort est souvent perçu comme aversif, il peut, chez certaines personnes et en fonction des situations, devenir une source de motivation, voire de plaisir.
Ce contraste illustre le « paradoxe de l’effort » : l’effort est à la fois perçu comme un coût et comme quelque chose de valorisé. Pour mieux comprendre ce paradoxe, et enrichir la théorie de la minimisation de l’effort en activité physique (TEMPA), nous avons proposé dans une publication scientifique récente de distinguer trois phases clé au cours desquelles la perception de l’effort influence de manière spécifique la régulation de nos comportements : avant, pendant et après l’action.
Avant l’effort physique : l’anticiper freine l’action
Avant de passer à l’action, notre cerveau évalue si le bénéfice potentiel vaut l’effort requis. Ainsi, entre monter un escalier ou prendre l’escalator, la tendance automatique de la plupart des personnes est d’éviter l’effort physique.
En conditions de laboratoire, des participants manifestent aussi une préférence spontanée envers les actions demandant moins d’effort, même sans percevoir consciemment la différence. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par des comportements très concrets : plus de 90 % des individus optent pour l’escalator plutôt que l’escalier lorsqu’ils ont le choix.
Mais dans la vie réelle, le choix entre deux comportements ne se résume pas à la seule différence d’effort à fournir. Certaines activités exigeantes sur le plan physique, comme la course, la danse ou le jardinage, ou sur le plan mental, comme les mots croisés, les échecs ou le sudoku, sont aussi choisies en raison des récompenses qu’elles procurent, telles que le plaisir, la fierté, le bien-être, le sentiment d’accomplissement. Dans ces cas, l’effort anticipé peut certes constituer un frein, mais il ne suffit généralement pas à dissuader l’engagement dans une activité désirée.
Pendant l’effort : économiser l’énergie
Une fois engagés dans l’action, nous cherchons à limiter notre dépense énergétique en réduisant l’effort fourni – tout en atteignant nos buts. Par exemple, lorsque l’on court pour attraper un bus, on ralentit dès qu’on est sûr de l’attraper. Ce mécanisme, hérité de l’évolution, s’inscrit dans un héritage évolutif crucial à la survie.
Dès l’enfance, ce mécanisme d’économie d’énergie émerge. Les tout-petits passent d’une démarche maladroite à un pas nettement plus économe. En laboratoire. Des chercheurs ont même équipé des adultes d’un exosquelette – un cadre robotisé fixé aux jambes – pour rendre leur marche habituelle plus coûteuse. Ils ont alors observé que très rapidement ces derniers réajustent la fréquence et l’amplitude de leurs pas pour réduire l’effort à fournir, même lorsque les gains d’énergie sont minimes.
Ce résultat souligne comment notre système moteur s’adapte aux contraintes environnantes pour converger vers un optimum énergétique. Chez les coureurs d’élite, la foulée, le balancement des bras et la répartition de l’effort sont finement calibrés, démontrant l’importance de cette stratégie tant ici pour la performance sportive que plus largement pour la survie.
Ainsi, minimiser l’effort ne signifie pas refuser l’effort, mais l’employer judicieusement pour atteindre ses objectifs sans gaspiller d’énergie.
Après l’effort, la récompense perçue est renforcée
Après l’action, nous avons tendance à accorder d’autant plus de valeur au résultat que l’effort fourni a été important. Imaginez gravir une montagne à la force de vos mollets. Le sentiment d’accomplissement en magnifie la vue, alors qu’un trajet en téléphérique, aussi spectaculaire soit-il, laisse souvent un souvenir moins marquant. Cet effet, baptisé « Ikea effect » en référence à la satisfaction d’avoir soi-même monté ses meubles, montre que les récompenses gagnées au prix d’un effort paraissent plus gratifiantes.
En laboratoire, cet effet se vérifie par des mesures de l’activité encéphalographique. Lorsque les participants choisissent entre tâches à faible ou intense effort pour obtenir une récompense, l’activité neuronale associée à la récompense est plus intense après un effort élevé. Autrement dit, même si nous cherchons à éviter l’effort, une fois celui‑ci accompli, nous jugeons les gains obtenus d’autant plus gratifiants.
Ce phénomène, appelé justification de l’effort, est une forme de dissonance cognitive décrite il y a plus de soixante ans par le psychologue américain Leon Festinger. Ce mécanisme illustre comment, par réinterprétation, pour atténuer l’inconfort ressenti lors d’une tâche exigeante, nous justifions l’effort important consenti en attribuant une valeur supérieure au résultat obtenu. Cette théorie aide à comprendre le paradoxe de l’effort : bien que nous évitions généralement l’effort, il peut aussi être activement recherché car il signale l’obtention de récompenses potentielles.
Exploiter le rôle dynamique de l’effort pour promouvoir l’engagement dans des tâches exigeantes
En jouant sur les trois phases de l’effort, il est possible de remodeler la perception de l’effort et d’encourager, entre autres comportements, la pratique régulière d’activité physique.
Avant l’effort, ajuster les attentes liées à l’effort permettrait de lever les freins associés la surestimation de l’effort. De courtes séances d’initiation, un retour d’expérience personnalisé, ou une progression graduelle, aide à calibrer ces attentes, surtout chez les personnes les plus sédentaires. Attention toutefois : sous-estimer l’effort réel risquerait de provoquer une déception et de freiner les tentatives suivantes.
Pendant l’effort, détourner l’attention des sensations désagréables (fatigue, inconfort) à l’aide d’éléments externes (musique, environnement perçu comme agréable…), ou se projeter mentalement ailleurs, peut diminuer la perception de l’effort et améliorer les ressentis émotionnels. De même, adapter l’intensité, la durée et le type d’exercice aux préférences de chacun rend l’expérience plus agréable et renforce la motivation.
Après l’effort, il convient d’encourager la prise de conscience des efforts réalisés et des bénéfices immédiats (meilleure humeur, énergie, sentiment de vitalité et de bien-être…). En associant systématiquement l’effort à ces récompenses, on crée une dynamique vertueuse qui incite à persévérer.
Contrairement au fait d’évoquer les bénéfices à long terme sur la santé – même s’ils sont réels –, ce sont ces expériences affectives positives qui constituent l’un des leviers les plus puissants pour encourager une pratique régulière de l’activité physique.
Peut-on apprendre à aimer l’effort ?
L’effort, souvent vu comme un coût, peut aussi accroître la valeur que l’on perçoit d’une activité donnée, surtout quand cette activité procure in fine des bénéfices tangibles. Ce type d’associations pourrait expliquer pourquoi certaines personnes valorisent plus que d’autres, les tâches exigeantes, que ce soit mentalement ou physiquement.
La théorie de « l’ardeur apprise » suggère que l’effort devient gratifiant quand il est associé à des récompenses répétées, même simples comme des encouragements. Des études montrent que des participants récompensés pour des tâches difficiles tendent à persévérer dans d’autres efforts, même une fois que les récompenses en ont été tirées.
Cependant, l’effort peut-il être une récompense en soi ? D’un point de vue évolutif, économiser l’énergie est essentiel, et choisir l’option la plus économique semble logique. Chercher l’effort sans bénéfice peut être contre-productif, voire devenir pathologique (addiction, anorexie). L’effort devient valorisé quand il est associé à des expériences positives (fierté, sentiment de compétence). Ce n’est donc pas l’effort lui-même qui est gratifiant, mais ce qu’il permet d’atteindre, en dépit de son coût.
Apprendre à exploiter l’effort pour les bénéfices qu’il procure
L’effort guide nos comportements à chaque étape de l’action : avant, il façonne nos décisions ; pendant, il guide la manière dont nous allouons notre énergie ; après, il peut renforcer la valeur du résultat obtenu.
En jouant sur cette dynamique – recalibrer nos attentes, alléger le ressenti de l’effort en temps réel et souligner les récompenses glanées – on peut transformer l’effort en moteur durable d’engagement, voire susciter le goût de l’effort.
Plutôt que d’en subir le coût, nous apprendrions ainsi à exploiter l’effort pour apprécier les bénéfices qu’il procure.
Boris Cheval, Associate professor, École normale supérieure de Rennes; Florent Desplanques, Professeur agrégé d'EPS, chargé d'enseignement, École normale supérieure de Rennes et Silvio Maltagliati, Maître de conférence, Université Bretagne Sud (UBS)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.