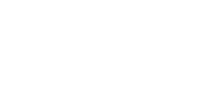Savoir nager : pourquoi ce qu’on apprend à l’école ne suffit-il pas à lutter contre les noyades ?
le 3 septembre 2025
Article de Léa Gottsmann, maîtresse de conférences à l'École normale supérieure de Rennes, republié à partir de The Conversation.
« Le savoir-nager est une priorité nationale de prévention et de sécurité », a rappelé le ministère de l’éducation nationale dans sa conférence de rentrée. Mais si tous les élèves sont censés valider une attestation du savoir-nager en sixième, est-ce bien le cas ? Et cette attestation les prémunit-elle des risques de noyade en milieu naturel ?
L’actualité estivale est chaque année marquée par un nombre important de drames relatifs à des noyades en France. 2025 ne fait pas exception : un rapport Santé publique France le pointait dès le début de l’été avec déjà 429 noyades, dont 109 suivies de décès.
Ce rapport marque encore une augmentation des chiffres par rapport aux années précédentes, particulièrement chez les plus jeunes dans un contexte de forte chaleur en début d’été. En 2025, sur la période du 1er juin au 2 juillet, 15 décès étaient ainsi relevés chez des mineurs lors de noyades en cours d’eau (contre 3 en 2024). Les chiffres précisent que ces noyades ont lieu dans les cours d’eau (39 %), en mer (30 %), dans les plans d’eau (16 %) et dans les piscines privées familiales (14 %).
La question du « savoir nager », « savoir se sauver » et « savoir sauver l’autre » est donc particulièrement à interroger dans le cadre du milieu naturel et des loisirs individuels.
Des actions de sensibilisation sont réalisées, mais ne suffisent pas face à la recrudescence des loisirs aquatiques, particulièrement dans des épisodes de fortes chaleurs de plus en plus réguliers.
Plus encore, malgré l’ambition affichée que l’ensemble des élèves obtienne l’attestation du « savoir nager », la réalité est bien différente et marque des inégalités sociales et territoriales. 82,9 % des élèves de sixième étaient titulaires de l’attestation en 2023, ce chiffre descendant à 72,5 % pour les établissements en éducation prioritaire, et sous la barre des 70 % pour les territoires et départements outre-mer.
Une réduction constante des moyens
Malgré l’importance de cet enjeu de santé publique et l’héritage annoncé des Jeux Olympiques de Paris 2024, l’accès pour toutes et tous à des conditions adéquates de pratique aquatique reste inégal sur le territoire. Les difficultés financières des piscines et des communes, en même temps que la réduction des moyens alloués aux établissements scolaires, maintiennent certains publics éloignés de conditions favorables de pratique pour apprendre le « savoir nager ».
Malgré des tentatives de compensation du manque d’installations (classes bleues, piscines mobiles…), ce clivage maintient, voire accentue les inégalités sociales entre les enfants dans l’accès à la pratique sportive et particulièrement dans des activités de prévention pour la santé. L’accès à des piscines familiales ou privées par exemple fait partie des critères de distinction marquants, accentuant ces différences de pratique de la natation et d’habitudes à se déplacer dans l’eau.
Une vision « magique » du transfert entre la piscine et le milieu naturel
L’attestation scolaire du « savoir nager » est obtenue en piscine, dans des conditions standardisées de pratique mais éloignées de toute incertitude liée à une pratique en milieu naturel. Pourtant, les caractéristiques de la natation en milieu naturel – plan d’eau, mer, rivière..- sont particulières. Les individus qui ont surtout connu des expériences en piscine peuvent rapidement se trouver en difficulté ou en situation de noyades.
La température de l’eau, la visibilité, les courants, la flottabilité ou encore le type de fond et son instabilité peuvent perturber les repères et créer de l’incertitude à laquelle les enfants ou adultes ne sont pas préparés.
De la même façon que nous n’apprenons pas à nager en dehors de l’eau, savoir nager et s’engager en sécurité au sein d’un milieu naturel ne s’apprend pas uniquement en piscine ou par l’attestation unique du « savoir nager ». Les chiffres révèlent bien cette proportion importante d’accidents en milieu naturel, par des imprudences ou des accidents relatifs à une mauvaise connaissance de soi et de son environnement.
Apprendre « en dehors » de l’école
Plusieurs travaux cherchent à développer des dispositifs pédagogiques qui permettent de faire pratiquer les élèves dans un milieu naturel de façon régulière (plan d’eau ou mer notamment). L’objectif est de pouvoir permettre aux enfants de développer un ensemble de repères sur eux, sur les autres et sur l’environnement naturel afin de pouvoir s’engager en toute sécurité et de façon respectueuse par rapport à la nature.
L’enjeu doit être de passer d’une vision de l’eau comme hostile, à laquelle on cherche à s’opposer, à se confronter ou à dominer, à une vision plus sereine, où l’on se sent appartenir à la nature en apprenant à utiliser les éléments naturels de façon positive et respectueuse (courant ou flottaison par exemple).
Encourager ces activités en milieu naturel, proches de ce que les enfants et futurs adultes vont vivre en dehors de l’école, est une piste prometteuse à la fois pour permettre de développer des compétences adaptées et sécuritaires à ce milieu mais aussi pour répondre à des enjeux environnementaux par une reconnexion plus sereine à la nature via les activités physiques et sportives.![]()
Léa Gottsmann, Maîtresse de conférences, École normale supérieure de Rennes
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
- Thématique(s)
- Diffusion des savoirs, Recherche - Valorisation
Mise à jour le 17 septembre 2025